Colloque annuel
Notre édition 2025


















































La 2e édition du colloque annuel de la Chaire d’études asiatiques et indo-pacifiques du CÉRIUM a réuni, la semaine dernière, chercheur(euse)s, expert(e)s et étudiant(e)s autour d’un thème central : Les stratégies Indo-pacifiques vues par l’Indo-Pacifique : perceptions, positionnements et perspectives critiques. L’événement a débuté par une série de discours d’ouverture marquants, suivis de différents panels qui ont apporté un regard neuf et dynamique sur les enjeux de la région.
Dès l’ouverture, plusieurs figures importantes ont pris la parole pour poser le cadre des discussions. Carl Bouchard, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, a donné le coup d’envoi, suivi d’Akihiko Uchikawa, consul général du Japon à Montréal, de Bernard Denault, directeur général Europe, Indo-Pacifique et affaires institutionnelles au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et de Patrick Leblond, professeur à l'École des affaires publiques et internationales de l’Université d'Ottawa. Tous ont souligné à quel point l’Indo-Pacifique est devenu un acteur incontournable des relations internationales, tant sur le plan économique que sécuritaire. La région, avec sa croissance économique rapide et sa place centrale dans les échanges mondiaux, exerce une influence croissante. M. Denault l’a mentionné, l’Indo-Pacifique est « le nouveau centre géopolitique et économique de la planète ».
Mais au-delà des grandes stratégies mises en place par des puissances comme les États-Unis, la Chine ou le Japon, ce sont surtout les perspectives locales qui ont été mises de l’avant. Comment les pays de la région naviguent-ils entre ces influences ? Quels sont leurs intérêts et leurs priorités ? Comme l’a mentionné Dominique Caouette, titulaire de la Chaire, il est primordial de « renverser la perspective et donner la parole aux experts de la région ». En confrontant ces différentes visions, le colloque a permis de mieux comprendre les dynamiques en jeu et les défis à venir.
La première journée a rassemblé des spécialistes reconnu(e)s qui ont analysé les transformations des politiques étrangères dans la région, la sécurité économique et les enjeux socio-politiques émergents. La deuxième journée, quant à elle, a mis l’accent sur les présentations étudiantes, leur offrant une tribune pour explorer divers aspects des stratégies géopolitiques, économiques et culturelles en Indo-Pacifique. Par exemple, les étudiant(e)s ont abordé des thèmes aussi variés que la stratégie indo-pacifique de la Chine, l'impact des accords sur le statut des forces militaires dans des pays comme le Sri Lanka, et les défis liés à la sécurisation de l'intelligence artificielle dans les relations bilatérales entre la Chine et l'Union européenne. Ils et elles ont aussi discuté de la résilience des aires marines tropicales face aux changements climatiques, en prenant pour exemple le cas de Raja Ampat, et exploré les mouvements d’opposition à la Belt and Road Initiative (BRI) en Asie du Sud-Est.
Le colloque s'est conclu par une table ronde captivante sur les perspectives des quatre prochaines années dans l’Indo-Pacifique. Des experts de la question, soit Won Deuk Cho (Korea National Diplomatic Academy), Jeffrey Ordaniel (Tokyo International University), Rachel Silvey (Université de Toronto) et Kensuke Yanagida (Japan Institute of International Affairs), ont échangé sur les dynamiques géopolitiques à venir, les défis sécuritaires et les opportunités de coopération dans la région. Une discussion éclairante, animée par Amandine Hamon, qui a permis de mettre en perspective les enjeux abordés tout au long de l’événement.
Ce colloque, qui a offert une belle occasion d’explorer l’Indo-Pacifique autrement, a été réalisé par la Chaire d’études asiatiques et indo-pacifiques du CÉRIUM, coordonnée par Alexandra Parada, avec le soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la Fondation Asie Pacifique du Canada et du Consulat du Japon à Montréal.
Retrouvez le programme complet ici.
Notre édition 2024



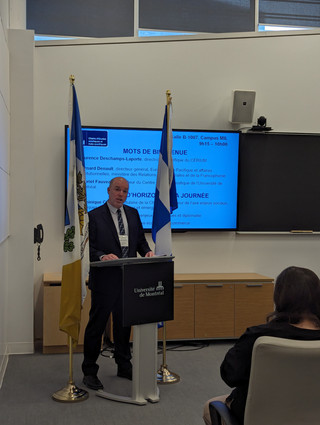
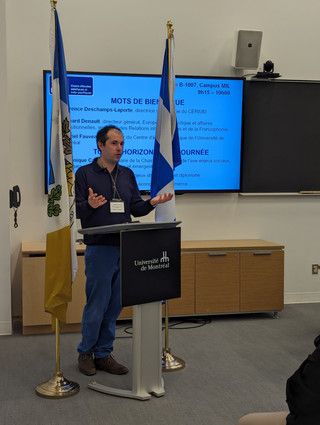
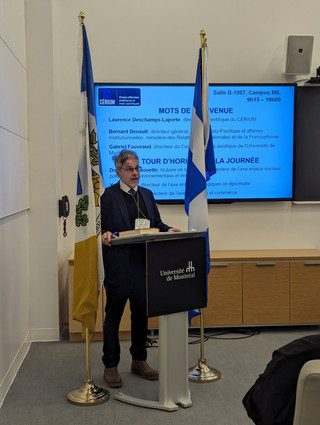









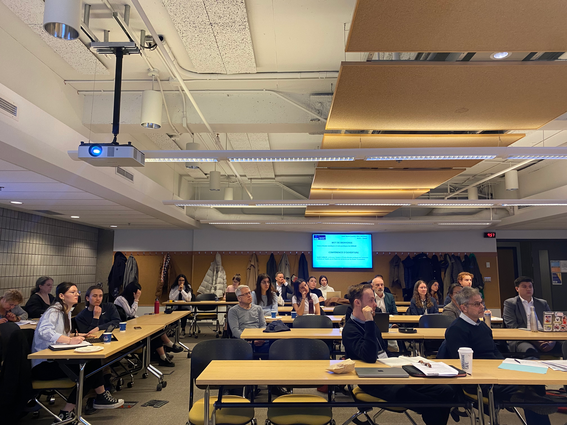



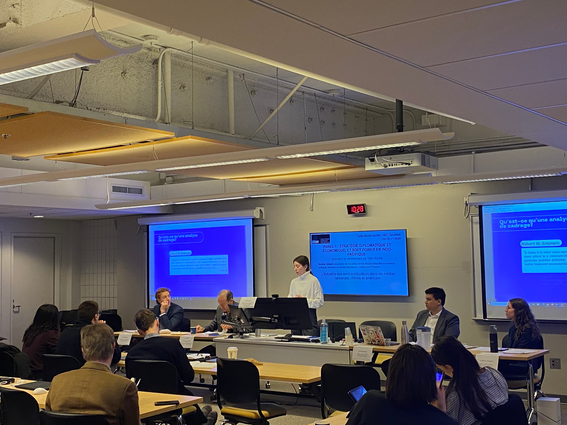

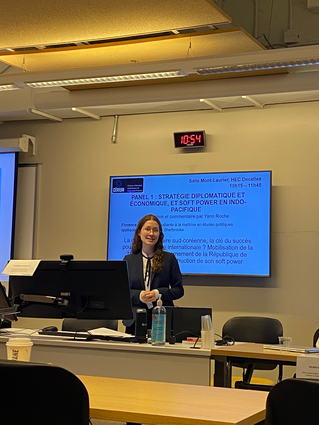
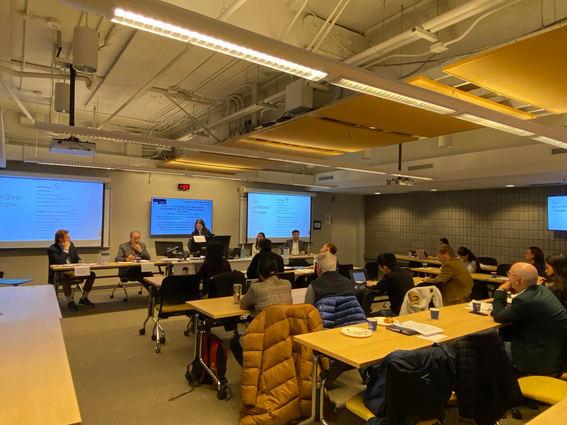

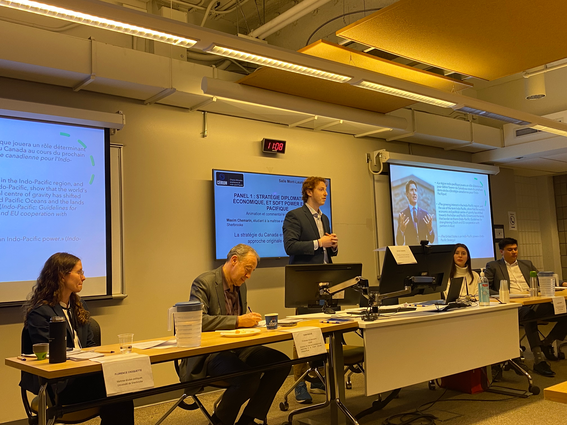

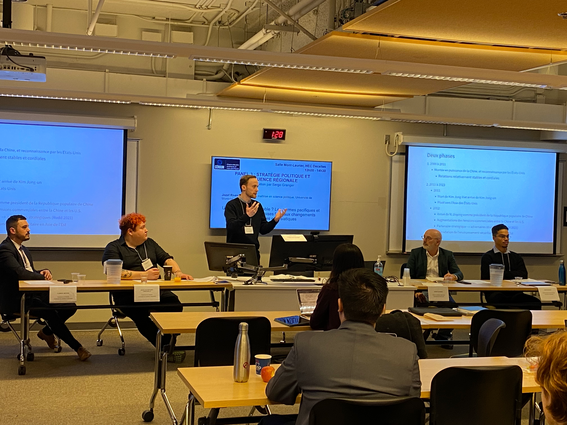
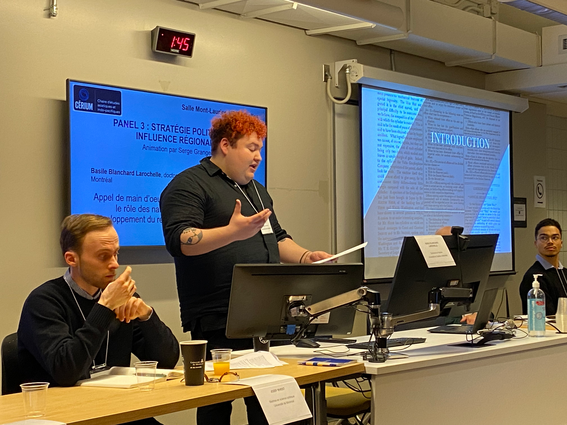




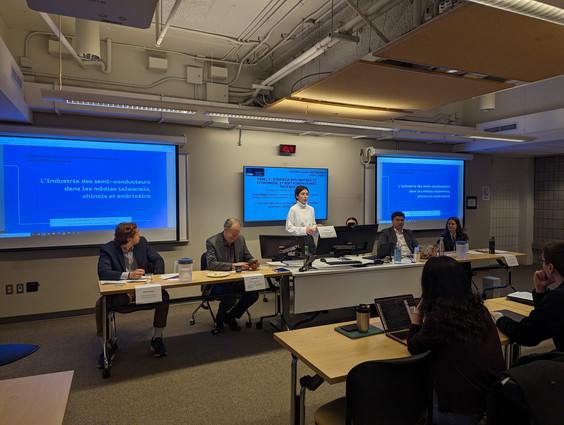



Les 27 et 28 mars derniers avait lieu le premier colloque annuel de la Chaire d'études asiatiques et indo-pacifiques. Au total, 10 conférences en français s'articulant autour des trois axes de la Chaire ont été présentées devant plus de 70 personnes.
Le colloque a mobilisé des étudiant(e)s et professeur(e)s de la communauté universitaire du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, en plus de professionnel(le)s de divers milieux (journalisme, ONG, fonction publique). Cette diversité de panélistes a incarné profondément l'esprit du titre Regards croisés et pluriels sur l'Indo-Pacifique. « Cette région, est très vaste et ce qui est intéressant est de la voir comme un ensemble hétérogène, mais aussi comme des sous-régions avec leurs dynamiques internes » a expliqué Yann Roche (UQAM), directeur de l'axe Stratégie et diplomatie.
En effet, les sujets abordés par les intervenant(e)s traitaient d'enjeux tant internationaux, que nationaux, tant intrarégionaux qu'interrégionaux, à petite et à grande échelle. Ce magnifique tour d'horizon a très bien illustré les paroles d'ouverture de Dominique Caouette (UdeM), titulaire de la Chaire et directeur de l'axe Enjeux sociaux, politiques, environnementaux et émergents : « L'Indo-Pacifique est une région de contrastes et de contradictions. »
Sans aucun doute, tous les regards sont rivés vers l'Indo-Pacifique non seulement pour les élections majeures qui s'y déroulent en 2024 (en Inde, Indonésie et Corée du Sud, entre autres), mais aussi parce qu'il s'agit d'une région regroupant près de 40 pays, 4 milliards d'habitants et totalisant plus de 47 billions de dollars de PIB. Évidemment, l'axe Économie et commerce, dirigé par Ari Van Assche (HEC Montréal) a mis en lumière les défis et opportunités que représente cette région en pleine émergence sur la scène internationale.
Cet événement a été réalisé grâce à la collaboration de la Chaire d'études asiatiques et indo-pacifiques, coordonnée par Alexandra Parada, aux étudiant(e)s organisateur(ice)s, au CÉTASE, et au soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
